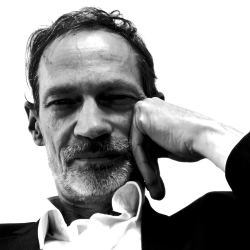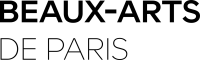La collection d’art de l’Académie royale de peinture et de sculpture
La collection d’art de l’Académie royale de peinture et de sculpture
Au cours de ses 150 ans d’existence (1648-1793), l’Académie royale de peinture et de sculpture a rassemblé plus de 15 000 œuvres d’art (peintures, sculptures, estampes, dessins, moulages et médailles). Le cœur de cette collection était constitué de morceaux de réception, des œuvres que les aspirants artistes soumettaient à l’examen de l’Académie pour en devenir membres. La collection comprenait également des peintures et bas-reliefs lauréats du Prix de Rome, des portraits commandés des mécènes de l’Académie, des « académies » réalisés par des étudiants et des professeurs, des moulages en plâtre de sculptures classiques, divers dons d’œuvres d’art, du mobilier et des objets inclassables (tels que des squelettes utilisés pour l’enseignement de l’anatomie humaine).
Comme presque tous les artistes éminents de l’ancien régime étaient membres de l’Académie royale, sa collection comprenait des morceaux de réception aussi célèbres que Le Pèlerinage à l’île de Cythère de Watteau (1717), La Raie de Chardin (1728) et Septime Sévère et Caracalla de Greuze (1769). Ces œuvres, ainsi que d’autres morceaux de réception, offrent aujourd’hui un aperçu précieux des valeurs esthétiques de l’institution. Les « académies », les plâtres et les autres objets utilisés dans l’enseignement mettent en lumière le processus éducatif. Les portraits commandés des mécènes de l’Académie et les œuvres d’art données éclairent les réseaux personnels qui en sont à l’origine. Collectivement, ces objets révèlent comment se percevait et se positionnait l’institution artistique la plus influente de l’Europe du XVIIIe siècle.
Au fil du temps, la collection a changé plusieurs fois de domicile, passant de Saint-Eustache à l’Hôtel Clisson, rue Sainte-Catherine, et au Palais-Royal, mais pendant la majeure partie de son histoire, de 1692 à 1793, elle a été logée au Louvre. La mise en place de la collection au Louvre était un important pendant « interne » à l’exposition publique de l’Académie, le Salon. Contrairement au Salon Carré, les salles principales de l’Académie étaient réservées à un nombre restreint de visiteurs triés sur le volet. Cependant, les œuvres qu’elles abritaient revêtaient une grande importance pour les étudiants et les membres, dont beaucoup non seulement travaillaient mais aussi résidaient au Palais.
Après la Révolution française, la collection d’art de l’Académie a été dispersée et est aujourd’hui partagée entre le Louvre, le Château de Versailles, l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris (ENSBA) et de nombreux autres musées en France et dans le monde.
En collaboration avec le Centre Dominique-Vivant Denon (Louvre), l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et les Beaux-Arts de Paris, nous avons initié un projet visant à reconstituer la collection de l’Académie royale à l’aide de méthodes numériques. La première phase du projet a consisté à créer une base de données établissant quels objets composaient la collection et où ils sont conservés aujourd’hui. Afin de démontrer l’importance de la collection pour la compréhension de l’art de l’ancien régime, nous avons également lancé une série de livres, qui s’est ouverte avec un volume sur les morceaux de réception, publié en juillet 2025. La prochaine étape du projet sera la création d’un modèle 3D recréant numériquement la disposition de la collection dans le Louvre du XVIIIe siècle.
Partenaires du projet
- Anne Klammt (Hannah Arendt Institute for Totalitarianism Studies – TU Dresden)
- Sofya Dmitrieva
- Françoise Mardrus et al. (Centre Vivant Denon, Musée du Louvre)
- Alice Thomine-Berrada (Beaux-Arts de Paris)
- Juliette Trey (Institut national d’histoire de l’art (INHA))
Date de début
01.07.2022
Publications
Sofya Dmitrieva, « The Art Collection of the French Royal Academy of Painting and Sculpture: Notes on the Database », Journal18, février 2025, www.journal18.org/7671.